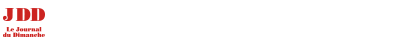QUAND LES ADOS TRANSGENRES REGRETTENT…
Un nombre croissant de très jeunes filles veulent devenir des garçons, sans toujours en mesurer les conséquences à long terme Des parents s’inquiètent de la prise trop rapide d’hormones, tandis que les ablations des seins augmentent fortement
LAURE MARCHAND
Pour ses 18 ans, Iris* veut une mastectomie, une opération chirurgicale qui consiste à se faire enlever les seins. Elle souhaite également prendre de la testostérone pour devenir un garçon – « transitionner ». Quand sa mère lui a prudemment fait remarquer que la démarche n’était pas « anodine », l’adolescente a rétorqué : « Mais non, c’est comme changer de couleur de cheveux. » En bleu, en blond… Après tout, pendant un temps, Iris faisait une nouvelle couleur chaque mois. « C’était joli, mais au bout d’un an ses cheveux ont commencé à tomber, elle avait comme un paillasson sur la tête », décrit sa mère. Cette professeure tente de tempérer les velléités de transformation de son aînée, de crainte que le corps de la jeune fille soit abîmé comme sa chevelure.
À l’instar d’Iris, de plus en plus de jeunes déclarent à l’adolescence une « incongruence de genre », c’est-à-dire qu’ils s’identifient au genre opposé à celui de leur sexe biologique. Lorsque le ressenti s’accompagne d’une souffrance, on parle de « dysphorie de genre ». En pleine expansion, ce coming out trans se retrouve dans tous les pays occidentaux. En Suède, pays qui tient des statistiques précises, les diagnostics de dysphorie de genre ont ainsi augmenté de 2 000 % en dix ans. Aux États-Unis, quelque 122 000 mineurs sont concernés – encore ce chiffre n’inclut-il pas les milliers d’autres non comptabilisés médicalement.
En France, le phénomène n’est pas quantifié mais il explose aussi. Actuellement, neuf consultations spécialisées existent en milieu hospitalier. Comme à l’hôpital pour enfants Robert-Debré ou à celui de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, aux CHU de Rouen ou de Lyon… Les listes d’attente débordent. À Sainte-Anne, dans la capitale, les délais sont tels que les nouvelles prises de rendez-vous ont été suspendues. Fait nouveau et constaté dans tous les pays concernés : ce sont désormais majoritairement des jeunes filles qui revendiquent un corps de garçon.
MODIFICATIONS IRRÉVERSIBLES
Cette nouvelle donne générationnelle est-elle la manifestation d’aspirations identitaires jusqu’alors étouffées, qui émergent plus aisément au sein d’une société plus libérale ? Faut-il y voir le symptôme de souffrances psychiques ? Quid des effets d’entraînement entre jeunes alimentés par les réseaux sociaux ? Comment expliquer la prévalence des filles ? Les hypothèses fracturent la communauté médicale. La rapidité et l’ampleur de cette croissance creusent un fossé de plus en plus large entre les partisans de la médicalisation pour soulager le mal-être de ces mineurs et ses détracteurs. Comme la mère d’Iris, face à leur adolescente ayant subitement déclaré « ne pas être née dans le bon corps », de nombreux parents s’alarment des conséquences irréversibles et des risques pour la santé des transitions médicales. Tous sont effrayés par la rapidité avec laquelle certains médecins entérinent les désirs de ces jeunes filles de changer de genre. Le point commun de ces histoires : aucun signe de dysphorie n’était apparu avant leur puberté.
Sans y parvenir à chaque fois, Isabelle essaie d’appeler sa fille, Anaïs, par le prénom qu’elle s’est choisi, Gaspard. La jeune fille de 18 ans a fait sa première injection de testostérone cet été et constate avec satisfaction que sa voix est en train de muer. Elle guette désormais avec impatience l’apparition d’une pilosité d’homme. C’est le cas pour son petit ami, Sacha, qui s’appelait encore il y a peu Alice et prend des hormones masculinisantes depuis un an. Quatre mois se sont écoulés entre l’annonce officielle par SMS d’Anaïs à son entourage et le début de son parcours de transition. Sa mère a tenté de la dissuader de prendre une décision qu’elle craint trop rapide, de peur que sa fille la regrette un jour. Celle-ci a coupé court en répondant que c’était « de la transphobie internalisée ». Mais en dépit de sa transition, Anaïs-Gaspard ne va toujours pas bien. Troubles anxieux sévères, pensées obsédantes de mutilation… La jeune personne, qui a toujours été un enfant peu sociable et mal à l’aise avec son corps, prend des antidépresseurs et des anxiolytiques.
Dans son cabinet parisien, Sylvie Zucca, psychiatre, reçoit des jeunes en plein questionnement sur leur genre. Elle juge primordial de ne pas se précipiter. « Lors de la puberté, les processus de maturation du cerveau sont en plein remaniement, il est donc important de ne rien figer à ce momentlà », déclare ce médecin, membre de l’Observatoire de la petite sirène. Codirigé par Caroline Eliacheff, pédopsychiatre, ce collectif de professionnels s’oppose aux « prises en charge médicales lourdes, systématiques et immédiates » chez les mineurs. Les associations LGBTQ+ accusent l’Observatoire de la petite sirène de transphobie, ce que ce dernier récuse. « La fluidité des genres, c’est un fait social contemporain, une manière d’avancer aussi dans le passage adolescent, mais selon moi, ça n’a rien à voir avec la gravité d’une médicalisation effectuée sans travail psychothérapeutique suffisant avant la majorité », ajoute Sylvie Zucca.
De nombreux médecins remettent en question la notion de « consentement éclairé » des adolescents. Selon eux, leur cerveau, qui n’achèvera sa maturation que vers 25 ans, n’est pas capable de mesurer toutes les conséquences à long terme d’une transition. L’hormonothérapie entraîne des modifications corporelles rapides. Certaines sont irréversibles, même en cas d’arrêt de la testostérone. C’est notamment le cas pour la voix, la pilosité, l’augmentation de la taille du clitoris ou la calvitie (qui dépend du patrimoine génétique). Au-delà de ces transformations physiques, les traitements hormonaux – qui sont prescrits hors autorisation de mise sur le marché (AMM) pour la transidentité chez les mineurs – peuvent avoir un impact sur la santé, avec des risques accrus, à terme, d’ostéoporose, de maladies cardio-vasculaires ou de thrombose.
Les partisans de l’autodétermination contestent cette approche. « Créer un cadre d’accompagnement global respectueux afin d’appréhender la demande dans toute sa complexité est au centre du débat, estime Simon Jutant, chargé du plaidoyer à l’association Acceptess-T et coauteur d’un rapport relatif à la santé et au parcours de soins des personnes trans demandé par Olivier Véran lorsqu’il était ministre de la Santé. Pour recueillir le consentement éclairé d’un enfant, on met en place un cadre thérapeutique qui prend en compte l’ensemble de son contexte de vie et va lui permettre de se débarrasser de la honte et de la peur. C’est ce qu’on qualifie d’accompagnement transaffirmatif. En France, le libre arbitre des mineurs concernant leur santé n’est pas nouveau, comme pour le recours à l’IVG, par exemple. »
UN DÉBAT INFLAMMABLE
En France, les données sur l’évolution des prises d’hormones ne sont pas publiques. Elles permettraient pourtant de quantifier précisément le nombre d’utilisateurs. Sur Internet, les listes de médecins et d’endocrinologues « trans friendly » circulent, car ils sont actuellement peu nombreux à accepter de les prescrire. Léonie a commencé à s’identifier à un garçon à 17 ans. Comme son groupe de copines du lycée et de la fac, toutes en transition, elle s’est alors rendue à des consultations du planning familial de Rennes. La branche locale du mouvement féministe est connue dans toute la Bretagne pour soutenir les parcours de transition. Légalement, la prescription d’hormones n’est pas accessible aux mineurs sans l’accord des deux parents. Léonie ne l’avait pas. Elle a donc patienté jusqu’à sa majorité, au printemps dernier. Quinze jours plus tard, « elle m’a annoncé avoir reçu sa première injection de testostérone, je ne risque pas de l’oublier, c’était le week-end de la Fête des mères », précise, grinçante, Laurence, sa mère.
Cette dernière l’assure : « Si Léonie persiste dans sa volonté, je la suivrai mais je veux qu’elle termine son adolescence avant et c’est peu dire qu’elle en est très loin. » Laurence a rejoint Ypomoni, un
« J’en ai rasle-bol d’être accusée d’être transphobe »
Laurence, mère de Léonie
collectif de parents opposés à la transition rapide chez les jeunes. Léonie – qui a été hospitalisée en psychiatrie quand elle était en seconde – montre de multiples signes de détresse psychique. Inquiète que le planning familial ne soit pas entré en contact avec les psychiatres qui suivent sa fille, Laurence l’a accompagnée à une consultation. « Le médecin a dit que seule son autodétermination comptait et elle n’a répondu à aucune de mes questions concernant les risques liés à la prise d’hormones. » À la fin de l’entretien, « elle m’a donné un dépliant sur le lexique transgenre et m’a demandé : “Connaissez-vous le taux de suicide des personnes trans non soutenues ?” ». Même Léonie a été choquée, fulmine sa mère. Plusieurs familles reprochent au planning familial 35 de ne pas prendre en compte le jeune dans sa globalité. Contacté par le JDD, le mouvement explique « délivrer les informations nécessaires pour que chaque personne puisse faire ses choix de façon éclairée », avant d’ajouter : « Le soutien parental est un enjeu majeur pour la santé mentale des personnes trans. Ces dernières années, la parole de “parents inquiets” est de plus en plus instrumentalisée par des mouvements réactionnaires. »
« J’en ai ras-le-bol d’être accusée d’être d’extrême droite ou transphobe, s’agace Laurence. Je suis de gauche, j’ai des beaux-parents homosexuels… Dans la famille, on n’est pas vraiment Manif pour tous. Là, on parle d’interventions sur des mineurs et de tout jeunes adultes ! » La mère de famille a écrit un courrier au Conseil national de l’ordre des médecins dans lequel elle questionne la déontologie des pratiques du planning familial de Rennes au regard du profil de sa fille. Au mois d’octobre, elle a reçu une réponse laconique de la section éthique et déontologie, qui renvoyait prudemment vers les travaux en cours de la Haute Autorité de santé (HAS). L’instance a été saisie par « le ministre chargé de la Santé […] pour que soient actualisées ses recommandations sur la prise en charge médicale qui datent de 2009 ». Elles sont attendues en septembre 2023 et concerneront les « personnes de plus de 16 ans ». Ce qui signifie que ses recommandations s’adresseront à la fois aux adultes et à la majorité des mineurs en demande de transition. D’ici là, la HAS ne communique pas.
Dans ce débat de société inflammable, institutions et pouvoirs publics prennent très peu position en France. Seule l’Académie de médecine s’est risquée, en février, à émettre un avis appelant à la prudence concernant les moins de 18 ans, compte tenu des changements de protocole dans plusieurs pays. « Au vu des preuves existantes », la Finlande juge que « la réassignation de genre chez les mineurs est une pratique expérimentale » et préconise depuis 2020 une approche psychosociale en première intention. La Suède, premier pays au monde à avoir reconnu la dysphorie de genre en 1972, est en train de réorganiser son système de soins de fond en comble : en début d’année, le Conseil national de santé suédois, concluant que « les risques des traitements hormonaux sont actuellement supérieurs aux bénéfices possibles », a demandé qu’ils ne soient plus « proposés que dans des situations exceptionnelles » aux mineurs. L’Angleterre s’alarme à son tour des dérives de l’unique établissement habilité à accompagner les moins de 18 ans. Le National Health Service (NHS), le service de santé publique, a programmé la fermeture de la clinique Tavistock au printemps prochain. De nouvelles directives pour accompagner les patients de façon pluridisciplinaire sont en préparation.
« Mon prénom, ma voix, mes seins, tout me manque »
Igor, 36 ans, autrefois Nelly
LE MALAISE DE LA PUBERTÉ
Face à la conviction soudaine de sa fille de « ne pas être née dans le bon corps », Delphine, scientifique au CNRS, s’est inquiétée. Elle a donc pris rendez-vous à la consultation « Variance du genre » proposée par l’hôpital lyonnais Le Vinatier pour Nathan, le prénom que Sybille s’est donné. Sans aucune idée préconçue sur la question. « À la deuxième consultation, j’ai demandé où en était le diagnostic. La psychiatre m’a répondu qu’il n’y en avait pas : c’est l’enfant qui sait dans quel genre il se reconnaît. Ma fille a 14 ans, a été abusée sexuellement plusieurs années, est autiste, en très grande dépression, au point qu’elle a pu passer dix semaines sans se laver, qu’elle reste prostrée dans son lit lorsqu’elle a ses règles, mais elle est capable de s’autodiagnostiquer… Les bras m’en sont tombés. » Des études dans plusieurs pays font émerger une surreprésentation des comorbidités chez les jeunes avec une dysphorie de genre : autisme, anxiété généralisée, dépression profonde, troubles du comportement alimentaire…
Sur Internet, les candidates à la mastectomie trouvent des vidéos de jeunes, torse plat et barré de deux larges cicatrices à la place des seins. Là aussi, les chiffres officiels sont introuvables. Mais selon les données de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (Atih) reprises dans le rapport remis au ministre de la Santé, cinq mineurs avaient effectué en 2011 un séjour hospitalier répertorié avec le code F64, celui du « transsexualisme ». En 2019, ils étaient 69. Soit une multiplication par 14. La chirurgie pelvienne pour transidentité étant interdite pour les mineurs, ne reste que celle de la poitrine. « Il n’est quand même pas compliqué d’extraire du nombre total de mastectomies réalisées celles qui sont codées avec un diagnostic de transsexualisme, s’agace un médecin longtemps responsable du département d’information médicale d’un hôpital. Les établissements font très attention au codage des actes pour être payés. Jusqu’à preuve du contraire et en tenant compte d’erreurs à la marge, ces chiffres correspondent donc essentiellement à ceux des mastectomies sur des mineurs. » Les « 17 ans et moins » sont la tranche d’âge qui a enregistré l’augmentation la plus marquée du recours à la chirurgie.
Cet été, à la quatrième consultation, NathanSibylle, qui ne voulait finalement plus entendre parler d’hormones, a demandé au médecin s’il était « possible d’avoir un torse de garçon ». « C’est son obsession, précise sa mère. Le médecin n’a répondu ni oui ni non. Mais elle a conseillé, à cause des délais d’attente, de prendre rendez-vous avec l’endocrinologue et les chirurgiens en amont, quoi que Nathan décide finalement. On se retrouve un peu coincés après, car cela a été dit en sa présence. » Nos sollicitations auprès de la responsable de la consultation sont restées sans réponse. Récemment, la jeune fille a confié à sa mère avoir l’impression terrible d’être tout le temps « regardée comme un objet sexuel ». « La voici, l’explication », pense Delphine.
« Le discours de ces jeunes filles est très formaté : “J’ai été assignée fille à la naissance”, elles disent toutes la même chose », constate une pédopsychiatre, qui tient à l’anonymat pour préserver les prises en charge en cours. À partir de mots identiques, elle tente de « décrypter ce qu’il y a derrière chaque demande ». Son expérience clinique de vingt-cinq ans lui fait dire que « la problématique transidentitaire recouvre toute la psychopathologie de l’adolescence ». « Une partie des jeunes que je vois s’engagent probablement dans une problématique psychiatrique, et chez certains, la transidentité est peut-être une solution, développet-elle. Pour les autres, il n’y a pas de troubles psychiques graves mais, dans certains cas, rien ne peut les faire bouger, un peu comme ceux embarqués dans l’anorexie ou la toxicomanie. » Chez ces adolescentes, le malaise du corps en transformation pubertaire est de l’ordre de l’insupportable, constate-t-elle : « Elles ont en commun de ne pas supporter leurs seins, elles veulent les faire disparaître. Cela pose question. Elles sont convaincues qu’une intervention réelle sur leur corps fera cesser leur souffrance. »
Pour les jeunes trans, la littérature scientifique sur les effets et bénéfices à long terme manque. Les récits de personnes abandonnant au bout de quelque temps leur transition commencent à apparaître dans les médias et sur les réseaux. Mais ces parcours restent très peu documentés. Igor, 36 ans, regrette la sienne**. De prime abord, impossible de deviner qu’il était une fille : sa démarche, ses traits et sa voix correspondent à ceux d’un homme. Un bonnet dissimule sa calvitie. Nelly a entamé sa transition à 23 ans pour devenir Igor. Au début, il était content. Les regrets sont arrivés peu à peu. Avec le recul, il pense que « les médecins ont cru bien faire » pour l’aider. Pour ne pas faire souffrir ses parents, il continue de faire comme s’il était toujours un homme. « Attention, je ne dis pas qu’il ne faut pas autoriser les transitions, certains en ont besoin, mais il faut prendre le temps de réfléchir. Aujourd’hui, mon prénom, ma voix, mes seins, tout me manque. »
La Une
fr-fr
2022-12-11T08:00:00.0000000Z
2022-12-11T08:00:00.0000000Z
http://lejournaldudimanche.pressreader.com/article/281479280455982
Lagardere